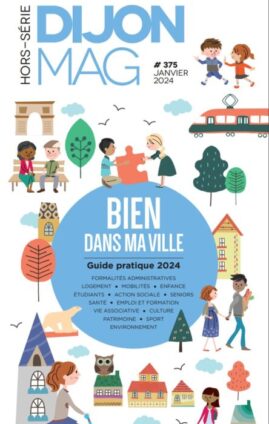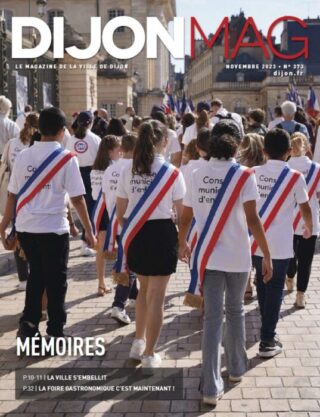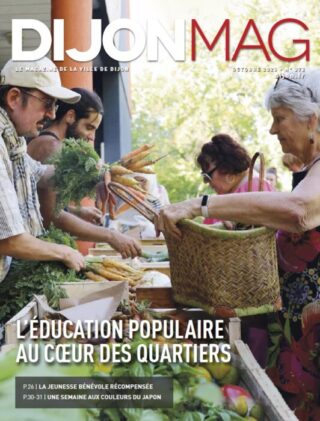À la une
Accès directs
Actualités


Citoyens et curieux, les coulisses des grands équipements de la métropole

Aménagement de la place du 30 octobre
Rues piétonnes autour des Halles
Pour la cinquième année consécutive, les rues autour des Halles de Dijon deviennent piétonnes à…
Le guide Terre de Jeux 2024
Découvrez le calendrier des manifestations, que vous soyez sportifs ou non !
Dijon sport découverte – Printemps 2024
Inscription du lundi 22 au dimanche 28 avril 2024.
Agenda
Quand la musique électro fait danser Dijon
Plus de 30 ans d’histoire culturelle à travers les archives au Musée de la vie Bourguignonne.
Mon prénom tactile
Écrire son prénom, oui, mais écrire un prénom que tu peux toucher, c’est encore mieux !…
Saison Clameur(s) : Escape Game
Pour vous immerger dans la thématique de Clameur(s), participez à un Escape Game ! Cette…
Saison Clameur(s) : Escape Game
Pour vous immerger dans la thématique de Clameur(s), participez à un Escape Game ! Cette…
Saison Clameur(s) : Escape Game
Pour vous immerger dans la thématique de Clameur(s), participez à un Escape Game ! Cette…
Saison Clameur(s) : Escape Game
Pour vous immerger dans la thématique de Clameur(s), participez à un Escape Game ! Cette…